Émilie Bruand et l’étude de la Terre ancienne
Entre 4 et 2,5 milliards d’années, c’est sa période préférée. Émilie Bruand, chargée de recherche du CNRS au laboratoire Geo-Ocean (GO, CNRS/Ifremer/Université de Bretagne Occidentale), scrute ainsi les plus anciennes traces géologiques de l’histoire de la Terre, notamment grâce à des minéraux plus résistants que les autres : apatite, titanite ou zircon.
A l'occasion de la journée internationale des femmes et filles de sciences, le 11 février 2025, et jusqu'à la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2025, découvrez la diversité des recherches menées par les scientifiques du CNRS à travers une série d'entretiens. Cette opération est labellisée Année des Géosciences 2024-2025. |
Quel est votre parcours ?
J’ai suivi un master spécialisé sur les magmas et les volcans, avant d’obtenir mon doctorat à Graz, en Autriche. J’y ai étudié la formation d’une chaîne de montagne du sud de l’Alaska : les Chugach Mountains. J’ai ensuite effectué deux postdoctorats au Royaume-Uni, à Portsmouth et à Oxford, où j’ai commencé à m’intéresser à l’évolution de la croûte continentale et à la formation des premiers continents de notre planète.
Je suis revenue en France en tant que postdoc avant d’obtenir l’année suivante, le concours de chargée de recherche au Laboratoire magmas et volcans (LMV, CNRS/IRD/Université Clermont Auvergne), puis je suis arrivée à Brest en 2022 au laboratoire Geo-Ocean.
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’aller vers les sciences et la recherche ?
C’est clairement grâce à ma professeure de SVT en cinquième, qui aimait beaucoup la géologie. Elle avait organisé, avec le professeur de latin, un voyage à Naples pour découvrir Pompéi et le Vésuve. Mais c’est une fois à l’université que j’ai vraiment considéré la recherche, car je voulais au départ faire un master pro.
Quels sont vos thèmes de recherche ?
Je m’intéresse principalement à la Terre ancienne, c’est-à-dire celle d’il y a entre 4 et 2,5 milliards d’années. La Terre est la seule planète du système solaire à avoir une tectonique des plaques, ce qui signifie qu’une partie de sa croûte est recyclée en permanence. À cause de cette dynamique spécifique à la Terre, et de l’érosion importante sur notre planète, nous n’avons pas d’échantillon de roche plus ancien que quatre milliards d’années, alors que notre planète est vieille de 4,5 milliards d’années.
J’étudie les meilleurs indices qu’il nous reste : des minéraux plus résistants que les autres. Ils se nomment zircon, apatite ou titanite. Bien que plus petits qu’une tête d’aiguille à coudre, l’érosion les a mêlés à des sédiments plus jeunes, que l’on retrouve sur tous les continents.
Quel regard portez-vous sur la place des femmes dans votre discipline ?
En géologie on doit être autour d’un tiers d’étudiantes et de chercheuses, mais je sais que cela dépend des pays. Lors de mon doctorat en Autriche par exemple, les thésardes étaient majoritaires, mais il n’y avait aucune femme aux postes de recherche. Heureusement, le CNRS fonctionne différemment.

Les géosciences sont une discipline en pleine mutation, notamment via leurs liens avec les sciences environnementales : en quoi vos travaux s’inscrivent-ils dans cette démarche ?
Ma spécialité touche à une science très fondamentale, mais elle a des liens avec l’extraction de ressources minières. Les minéraux qui nous aident à comprendre la Terre ancienne contiennent des terres rares, qui sont des matériaux critiques. Tous ceux que j’étudie sont extraits de manière industrielle pour fabriquer des écrans, des batteries, des ordinateurs… La science contribue à mieux cibler les gisements afin de les exploiter en broyant moins de roche, mais elle doit également sensibiliser les gens à économiser ces ressources précieuses. En effet, l’extraction d’un kilo de terres rares consomme trois fois plus d’eau que l’extraction d’un kilo d’aluminium. Elle nécessite également un traitement chimique bien plus polluant que la plupart des autres métaux. Avec Geo-Ocean et la maison des minéraux de la Presqu’île de Crozon, nous sensibilisons les scolaires et le public à ce sujet depuis trois ans à la Fête de la Science de Brest.
Les recherches en géosciences ne sont pas que des sciences de terrain, comment utilisez-vous aujourd’hui les technologies de pointe ?
Ici, à Geo-Ocean, nous disposons d’une plateforme analytique (PSO) liée à l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM, CNRS/IRD/Université de Bretagne Occidentale). Je peux y étudier des échantillons à l’échelle de quelques microns afin de dater et de comprendre comment ces roches se sont formées.
J’emploie notamment une microsonde électronique, qui offre une analyse chimique non destructive. Je peux également déployer un laser qui va réaliser une ablation de l’échantillon (10-90 microns), couplé à un spectromètre de masse. Cela me permet de connaître et de mesurer les éléments chimiques en présence, et en particulier des éléments traces utiles à la datation des roches.
Quel message souhaiteriez-vous faire passer à la jeune génération ?
Il peut facilement y avoir des a priori en géologie. Un de nos professeurs de licence nous disait que le travail sur le terrain était trop physique pour les filles, alors que je sais qu’il suffit d’être un peu sportive. Je repense à mon enseignante de cinquième, qui m’a dit que c’était possible. J’y ai cru et je l’ai fait. C’est important de trouver des modèles, que ce soit au collège, au lycée ou à l’université. De plus, on entend souvent que recherche et vie de famille ne sont pas compatibles. J’ai eu deux enfants pendant mes postdocs, ce n’était pas toujours facile, mais grâce à mon compagnon et à un vrai partage des tâches, je veux dire à toutes les jeunes femmes en doctorat ou en postdoctorat que c’est possible.
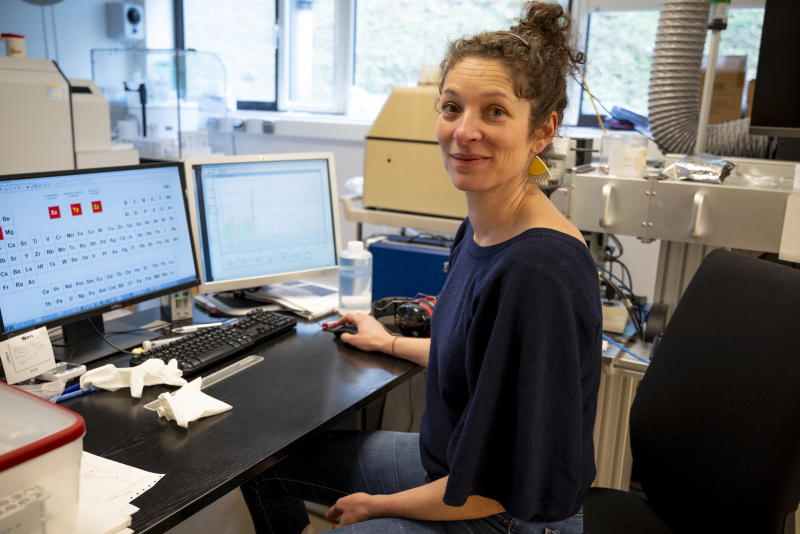
Retrouvez nos autres entretiens de femmes scientifiques :
2025 :
- « Susan Conway, un œil sur la surface de Mars »
- « La qualité de l’eau au cœur des travaux d’Émilie Jardé »
- « Isabelle Bihannic : l’imagerie au service de la recherche »
2024 :
- « Giulia Sacco, l’ingénierie au service de la santé »
- « Patricia Abellan : percer les secrets des matériaux »
- « Lucile Rutkowski : développer des instruments de A à Z »
- « Soizic Terrien : la dynamique des instruments de musique »
2023 :
- « Perrine Paul-Gilloteaux, informaticienne pour les sciences du vivant »
- « Marion Massé : géologue martienne »
- « Catherine Boussard-Plédel : objectif fibres optiques ! »
- « Gwenn Tanguy : mutualiser pour mieux partager au bénéfice de la recherche marine »
2022 :
